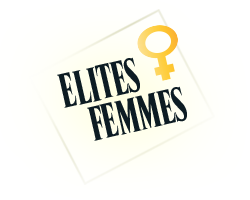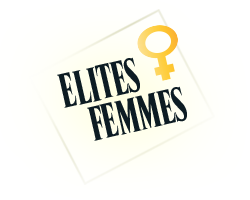
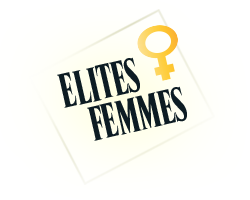
Burkina Faso : lancement officiel du numéro vert pour dénoncer le cas de violences basées sur le genre
Le Burkina Faso à le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire et ses partenaires a procédé ce jour 2 mars 2021 au lancement du numéro vert de dénonciation des cas de violences basées sur le genre.

Pour la ministre Hélène Marie Laurence Ilboudo / Marchal : « la création de ce numéro vert spécifique aux violences basées sur le genre répond à la persistance du phénomène et à l’insuffisance de mécanismes de dénonciation, ce qui constitue un frein à l’atténuation des risques de violences subies par les femmes et les filles. »
Il s'agit, selon la cheffe du département en charge de la solidarité nationale, d'une opportunité pour les professionnels d’apporter le soutien de premiers recours voire et au besoin, assurer une prise en charge et un suivi des bénéficiaires.

Totalement gratuite, cette ligne permettra, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à informer sur les cas ou tentatives de VBG. Toute personne victime de violences ou qui en est témoin est encouragée à appeler le 80 00 12 87 pour demander de l’aide, dénoncer ou obtenir de l’assistance selon une note de l’institution chargée de la femme.
La Rédaction
Reconstruisons-en mieux après la pandémie en favorisant la parité des sexes dans l'éducation et la formation
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence toute l'importance de l'équité dans l’éducation et la formation. Alors que de nombreux pays ont progressé sur la voie du renforcement du capital humain ces dernières années, la crise sanitaire met en péril (a) des avancées chèrement acquises, notamment en ce qui concerne la réduction des inégalités entre filles et garçons. Dans le monde entier, la transition vers l'apprentissage à distance imposée par la fermeture des écoles pose des problèmes (a) de connectivité et d'accès à l'éducation. Les filles sont souvent moins familières avec les technologies numériques et accèdent moins facilement à internet, ce qui risque de les empêcher d'acquérir les connaissances et savoir-faire demandés sur le marché du travail.
L'annonce tant attendue de vaccins prometteurs contre la COVID-19 est une avancée capitale pour endiguer la propagation du virus. Mais qu'en est-il de l'impact de la pandémie sur d'autres aspects de la vie des filles qui sont essentiels à leur croissance et à leur développement, comme l'accès à l'enseignement et à la formation, et par conséquent à l'emploi ?
La Journée internationale de l'éducation 2021 nous offre l'occasion de réfléchir à cette question, d'analyser les tendances passées en exploitant le portail de données de la Banque mondiale sur le genre et la parité des sexes, et de renouveler notre engagement à investir dans l'éducation des filles et à favoriser la participation des femmes à la vie active.
Les filles ont moins de possibilités d'apprendre que les garçons
Avant l'irruption de la COVID-19, les chiffres de la scolarisation au primaire et au secondaire étaient en progression régulière. Pourtant, l'indice mondial de parité des sexes révèle que les filles se heurtent à des inégalités d'accès à l'apprentissage persistantes. C'est en Afrique subsaharienne que les écarts en matière de scolarisation sont les plus marqués, tandis que dans quelques pays d’Amérique latine et des Caraïbes, les disparités s’inversent.
Les filles sont moins représentées que les garçons dans les filières de formation professionnelle
Les tendances montrent que la proportion de filles dans les programmes de formation professionnelle a toujours été inférieure à celle des garçons. Et, même dans les pays où l'égalité entre les sexes est relativement acquise, l'écart est constant, voire en augmentation. C'est là une réalité dans toutes les régions, sauf en Afrique subsaharienne où le fossé semble commencer à se combler.
Afrique australe. Des femmes et des filles en danger chez elles du fait du confinement lié à la pandémie de COVID-19
Lors des confinements imposés en Afrique australe face à la pandémie de COVID-19, des femmes et des filles ont été piégées chez elles avec leur partenaire violent, le foyer conjugal se transformant en un lieu de cruauté, de viol et de violence, avec des victimes n’ayant nulle part où aller pour signaler cette situation ou pour se réfugier, écrit Amnesty International dans rapport rendu public mardi 9 février 2021.
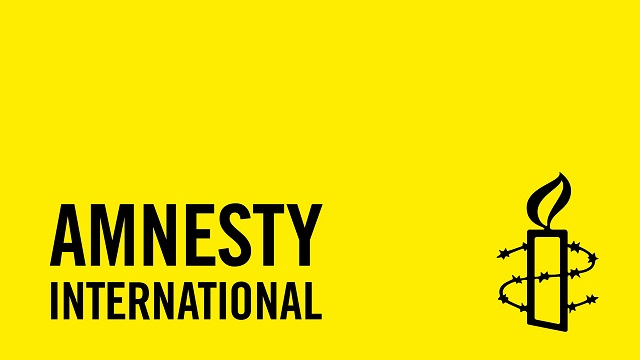
La pandémie de COVID-19 a donné lieu à une multiplication des violences liées au genre à l’encontre des femmes et des filles en Afrique australe.
Deprose Muchena, directeur du bureau régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe d’Amnesty International
Des stéréotypes néfastes sur le genre ont favorisé la montée de la violence à l’encontre des femmes et des filles dans les cinq pays d’Afrique australe examinés, à savoir l’Afrique du Sud, Madagascar, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe. Ces préjugés sont ancrés dans des normes sociales et culturelles qui véhiculent l’idée selon laquelle les femmes doivent toujours se soumettre aux hommes, et un homme qui bat sa femme le fait parce qu’il l’aime. Comme le déclare une militante au Mozambique : « On apprend aux filles que les maris ne battent leur femme que lorsqu'ils les aiment. »
Dans son rapport intitulé « Traitées comme des meubles ». Violences liées au genre et réponses au COVID-19 en Afrique australe, Amnesty International montre que les femmes et les filles qui osent signaler les violences et les agressions dont elles sont l’objet risquent d'être rejetées socialement parce qu'elles ne se conforment pas aux rôles attribués aux hommes et aux femmes. De surcroît lorsqu'elles se risquent à dénoncer ces violences, leurs plaintes ne sont pas prises au sérieux par les autorités.
« La pandémie de COVID-19 a donné lieu à une multiplication des violences liées au genre à l’encontre des femmes et des filles en Afrique australe. Elle a également amplifié des problèmes structurels déjà existants tels que la pauvreté, les inégalités, la criminalité, le taux élevé de chômage et les dysfonctionnements systématiques du système judiciaire », a déclaré Deprose Muchena, directeur du bureau régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe d’Amnesty International.
Les mesures de confinement ont empêché les femmes d’échapper à leur partenaire violent ou de quitter leur domicile pour chercher à obtenir une protection.
Deprose Muchena, directeur du bureau régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe d’Amnesty International
« Les mesures de confinement ont empêché les femmes d’échapper à leur partenaire violent ou de quitter leur domicile pour chercher à obtenir une protection. En Afrique australe, les femmes qui ont subi des violences liées au genre ont eu du mal à signaler les faits, car les personnes ainsi que les organisations œuvrant pour protéger et soutenir ces victimes n’ont pas été considérées comme un « service essentiel » ; ces femmes victimes de violences ont donc été confrontées aux restrictions strictes de déplacement, si bien qu’elles ont renoncé à porter plainte. »
Sur les cinq pays où la violence liée au genre est examinée dans ce rapport, l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Zimbabwe sont les seuls où les services d'aide aux femmes et aux filles victimes de violence n'ont pas été pris en compte dans l’élaboration des mesures visant à freiner la propagation du COVID-19.
Viols, coups et meurtres pendant le confinement
Dans les semaines qui ont suivi l’instauration de mesures de confinement dans la région, la violence contre les femmes a connu une flambée. Au cours de la première semaine de confinement, le service de police sud-africain (SAPS) a enregistré 2 300 appels à l'aide pour des violences liées au genre. À la mi-juin 2020, le pays comptabilisait 21 femmes et enfants qui avaient été tués par leur partenaire.
Le meurtre de Tshegofatso Pule a été une affaire emblématique. Cette jeune femme de 28 ans, qui avait disparu le 4 juin 2020, a été retrouvée quatre jours plus tard poignardée et pendue à un arbre à Johannesburg alors qu'elle était enceinte de huit mois.
Au Mozambique, des organisations de la société civile ont été saisies d’un nombre inhabituel de cas de violence domestique à la suite de l’instauration de l'état d'urgence en mars 2020. Dans une autre affaire, un homme a tué sa femme avant de se suicider. Cela a eu lieu le 6 juin dans le district de Matola de la province de Maputo.
En Afrique australe, les femmes qui ont subi des violences liées au genre ont eu du mal à signaler les faits, car les personnes ainsi que les organisations œuvrant pour protéger et soutenir ces victimes n’ont pas été considérées comme un « service essentiel ».
Deprose Muchena
Des détails horribles ont aussi été révélés concernant le kidnapping, le viol et le meurtre d'une employée de l'hôpital central de Maputo le 31 mai 2020. Elle était sur le chemin de retour du travail ; elle était rentrée tard en raison de la pénurie de transports en commun due aux restrictions pendant l’état d’urgence.
Au Zimbabwe, une organisation qui propose des services de protection aux femmes victimes de violence domestique a recensé 764 cas de violence liée au genre au cours des 11 premiers jours de confinement dans le pays. Au 13 juin 2020, ce nombre était passé à 2 768 cas.
Il y a aussi le cas de Maria (le nom a été modifié), originaire du Zimbabwe, qui a été chassée violemment de chez elle par son mari après qu’il a installé sa maîtresse à leur domicile pendant le confinement.
À Madagascar, l’augmentation de la pauvreté due au confinement a été un facteur majeur de la hausse du nombre de cas de violence liée au genre pendant cette période, les femmes et les filles devenant plus pauvres, plus dépendantes économiquement de leur partenaire violent, et donc plus exposées à ces violences.
Selon des statistiques officielles de la police nationale, la Zambie est le seul pays qui a enregistré un léger recul des cas de violence liée au genre pendant le confinement national par rapport à la même période en 2019. Le pays a enregistré une diminution de 10 % des cas signalés au premier trimestre 2020. Cette situation peut s’expliquer par le fait que les femmes n'ont pas pu appeler à l'aide et cela ne révèlerait pas une diminution des cas de violence liée au genre. Cependant, l'ONG Association chrétienne des jeunes femmes (YMCA) a enregistré une augmentation des cas de violence sexuelle au cours du premier trimestre de 2020.
Obstacles à la justice
Ce rapport met en évidence plusieurs obstacles d’accès à la justice auxquels se heurtent les victimes et les survivantes de la violence liée au genre en Afrique australe. Il s'agit notamment du manque de confiance dans la justice et du traumatisme secondaire que les victimes et les survivantes subissent souvent de la part des autorités, y compris la police, ainsi que des services de santé lorsqu'elles tentent de signaler les faits de violence.
Ces obstacles ont été accentués lors de la pandémie de COVID-19. En Afrique du Sud par exemple, l'opinion publique s'est indignée des manquements de la justice pour les femmes et les filles qui sont victimes de violences basées sur le genre, même s’il existe la Loi relative à la violence domestique de 1998 qui dispose explicitement que les victimes peuvent porter plainte contre leurs agresseurs.
Selon Natasha (le nom a été modifié), qui a été victime de viol, la violence contre les femmes a augmenté parce que « la police ne prend pas assez au sérieux les victimes de violence liée au genre lorsqu'elles portent plainte ».
Le ministre sud-africain de la Justice et du Développement constitutionnel, Ronald Lamola, a reconnu à la radio en juin 2020 des défaillances dans le système, qui a souvent négligé les besoins des victimes de violence liée au genre.
Au Mozambique, lorsqu'une plainte pour violence liée au genre est déposée, la police est tenue d'ouvrir une enquête. Comme en Afrique du Sud, de nombreuses victimes hésitent toutefois à témoigner en raison de la pression sociale pesant sur elles pour qu’elles supportent la violence conjugale, et à cause de la dépendance financière à l'égard de l'agresseur et du manque de confiance dans la justice.
Les États doivent veiller à ce que les femmes et les filles continuent de bénéficier de la protection policière et de la justice ainsi que des centres d’accueil et d’autres services d’aide pour échapper au fléau de la violence liée au genre.
Deprose Muchena
Selon des organisations de la société civile, des policiers ont parfois été accusés d’avoir rejeté des plaintes pour violence liée au genre parce qu'ils les considéraient comme des affaires familiales et non comme des infractions. La stigmatisation entourant la violence sexuelle a également été mentionnée comme un facteur contribuant à la sous-déclaration.
« Il est scandaleux que pour nombre de personnes en Afrique australe, l'endroit le plus dangereux pour être une femme ou une fille pendant la pandémie de COVID-19 soit son propre foyer. C’est tout simplement inadmissible. Les dirigeants de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) doivent veiller à ce que la prévention de la violence liée au genre et de la violence domestique ainsi que la protection contre celles-ci fassent partie intégrante des réponses nationales aux pandémies et autres situations d'urgence », a déclaré Deprose Muchena.
« Les États doivent veiller à ce que les femmes et les filles continuent de bénéficier de la protection policière et de la justice ainsi que des centres d’accueil et d’autres services d’aide pour échapper au fléau de la violence liée au genre. »
EDITORIAL : Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines : « Unissons-nous, finançons, agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines » (Par Vanessa Moungar)

Différents rapports indiquent que le phénomène a connu une résurgence à la suite de la pandémie de Covid 19, en particulier en Afrique de l’Est et de l’Ouest
Cette année, seulement une décennie nous sépare de l’échéance des Objectifs de développement durable de l’Onu, fixée à 2030. Malheureusement, alors que nous nous approchons de cette étape importante dans le progrès de l’humanité, nous sommes en train de perdre la bataille contre un problème qui touche des millions de filles et de femmes dans le monde.
Selon les dernières données de l’UNICEF plus de 125 millions de filles et de femmes de vingt neuf pays ont subi des mutilations génitales féminines (MGF), et cinq des pays où cette pratique est la plus répandue se trouvent en Afrique.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la mutilation génitale féminine comme la pratique de l’ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins externes ou d’autres lésions causées aux organes génitaux féminins, pour des raisons non médicales.
Différents rapports indiquent que le phénomène a connu une résurgence à la suite de la pandémie de Covid 19, en particulier en Afrique de l’Est et de l’Ouest. Les couvre-feux prolongés, les congés sans solde et les mises à pied ont restreint les déplacements, maintenu les familles confinées chez elles et réduit les perspectives de développement économique.
Les écoles, qui tiennent souvent lieu de refuge provisoire pour les filles ou les jeunes femmes issues de communautés pratiquant les MGF, ont fermé leurs portes, rendant les ex-élèves plus vulnérables aux pressions auxquelles elles sont soumises aux fins de leur faire subir cette épreuve supposée les rendre plus mariables. Certaines familles, confrontées à des difficultés économiques, considèrent la perspective d’une dot comme un encouragement monétaire à offrir leurs filles excisées, même à un jeune âge, comme épouses.
D’après des organisations militantes de la société civile, cette résurgence est également provoquée par l’absence d’un volet consacré aux mutilations génitales féminines dans les réponses contre la pandémie de Covid-19 dans les pays d’Afrique, ainsi que par le fait que le temps et les ressources ont été accaparés par la lutte contre la pandémie.
Alors que nous entrons dans la troisième décennie du XXIe siècle, il est évident que les mutilations génitales féminines perdent de plus en plus la faveur des populations dans les pays où elles sont pratiquées depuis des siècles. Par conséquent, le problème n’est donc plus d’ordre culturel : il se présente dorénavant sous les aspects des droits de la personne et de la santé, et même sur le plan économique.
L’OMS estime qu’en 2019, avant la pandémie, les coûts de santé pour les filles et les femmes ayant été victimes des MGF dans vingt-six pays d’Afrique s’élevaient à 1,4 milliard de dollars américains. Le nouveau calculateur du coût des MGF de l’organisation indique que, si les mutilations génitales féminines se poursuivent au rythme actuel, leur coût annuel atteindra 2,1 milliards de dollars par an d’ici à 2048. Les progrès réalisés dans la lutte contre cette pratique risquent d’être effacés en raison de sa résurgence provoquée par la pandémie.
En d’autres termes, les mutilations génitales menacent les efforts déployés par l’Afrique pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Nous ne pouvons donc pas laisser cette résurgence se poursuivre.
Les mesures d’intervention de la Banque africaine de développement face à la pandémie de Covid-19 se sont traduites par des dizaines de millions de dollars versés aux pays membres régionaux et une partie de cette aide a été utilisée pour lutter contre les violences basées sur le genre. Par exemple, en Afrique du Sud, la Banque a renforcé les mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre les violences basées sur le genre et les féminicides, surtout grâce au développement d’un système intégré d’information sur la gestion des violences basées sur le genre et des féminicides.
Ces opérations sont conformes à la Stratégie du Groupe de la Banque africaine de développement en matière de genre (2021-2025) qui repose sur l’autonomisation des femmes et des filles. Nous pensons que les interventions communes pour mettre fin aux mutilations génitales féminines auront un effet transformateur pour les femmes et les filles d’Afrique, ce qui permettra à la planète de se consacrer à l’atteinte des Objectifs de développement durable des Nations unies.
Alors que nous célébrons le 6 février la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines, la Banque africaine de développement prend acte de la nécessité urgente d’éliminer totalement les mutilations génitales féminines. Les femmes et les filles ne peuvent pas pleinement atteindre leur plein potentiel économique et social si leur vie est mise en danger par cette pratique traumatisante.
L’édition 2021 de la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines a pour thème : « Le temps de l’inaction mondiale est révolu : unissons-nous, finançons, agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ». Nous appelons les pays africains à inclure les services de santé et les services sociaux dans leurs plans nationaux de mesures d’intervention face à la pandémie de Covid-19, la prévention des MGF et le rétablissement des filles et des femmes l’ayant subie en étant des éléments essentiels.
Nous demandons la mise en place de davantage de partenariats régionaux et nationaux qui prennent en compte les réformes législatives, le renforcement de la responsabilité nationale et la mobilisation des ressources en faveur des efforts de lutte contre les MGF. Les partenaires doivent également investir dans la rescolarisation des filles, notamment celles qui ont dû abandonner leurs études en raison d’un mariage ou d’une grossesse précoce.
Nous soutenons les opérations visant à éliminer la pratique des MGF qui se sont avérées efficaces, notamment celles intégrant des innovations technologiques dans les initiatives de surveillance et de communication des informations, surtout dans les communautés isolées.
Les MGF n’offrent, en termes de santé, aucun bénéfice aux femmes et aux filles, et elles sont reconnues internationalement comme une atteinte à leurs droits de la personne, à leur santé et à leur intégrité. Joignez-vous à moi pour « nous unir, financer et agir » afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines.
Vanessa Moungar
Directrice chargée du Genre, des Femmes et de la Société civile à la Banque africaine de développement
Yasma Desreumaux avait un rêve. Participer au développement du sport – sa passion de toujours -, dans son pays natal, l’Algérie. Son rêve est, depuis 2017, une réalité. Yasma a ouvert le premier magasin Decathlon algérois et mène les équipes algériennes de la marque de sport. Sous son impulsion, entourée de centaines de coéquipiers recrutés localement, deux magasins Decathlon ont été ouverts, ainsi qu’un site de production de produits sportifs.

Découvrez le portrait de cette femme engagée, inspirante, volontaire. Une sportive qui oeuvre au quotidien pour promouvoir l’activité physique, allant de pair avec la parité et la durabilité. Une histoire vraie, actuelle, qui préfigure aussi le sport de demain.
Decathlon United – 100 000 collaborateurs rendant le sport accessible sur les cinq continents – s’engage auprès de Women Sports Africa en tant que Top Partenaire pour trois ans, de 2021 à 2024. Objectifs : mettre en valeur toutes les femmes inspirantes sur le continent africain, contribuer à la diffusion du sport et ses bienfaits en Afrique et partout dans le monde.
Ce partenariat s’inscrit dans les alliances de sens que Decathlon tisse avec les acteurs leaders du sport, dont Women Sports Africa dans le domaine du journalisme et du reportage.
« Nous, Decathloniens, dont la mission est de rendre le sport accessible au plus grand nombre, sommes très heureux de contribuer à l’essor du Sport au Féminin en Afrique auprès d’un groupe de presse de grande qualité, qui s’adresse à toutes et tous. Les valeurs d’équité, de partage, de tolérance, de bien-être à travers l’activité physique portées par le magazine et ses déclinaisons digitales sont, en tous points, les nôtres. »
Grâce à ses partenaires engagés, Women Sports Africa est diffusé gratuitement en ligne et en print sur l’ensemble du continent africain et particulièrement dans les 26 pays suivants : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo RC, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo et Tunisie.
Naïma El Guermah, directrice d’édition de Women Sports Africa : « Women Sports Africa est le média de référence pour les femmes par et avec le sport. Nous sommes fiers et très heureux d’accueillir Decathlon United en tant que Top Partenaire pour accélérer notre diffusion et le partage des plus belles histoires du Sport au Féminin en Afrique ! »
Source: Omnisport
Contacts presse Decathlon : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Contacts partenaires Women Sports Africa : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
La crise sanitaire de Covid-19 a exacerbé les inégalités entre les sexes dans le monde. Les femmes courent un risque beaucoup plus élevé que les hommes de perdre leur emploi en raison de la ségrégation sectorielle où elles sont surreprésentées dans les industries affectées négativement par la pandémie, comme les services d'alimentation et de vente au détail. De plus, les garderies fermées et l'enseignement à distance pour leurs enfants obligent les femmes, par exemple, aux États-Unis, à conserver la main-d'œuvre quatre fois plus vite que les hommes . Et en Inde, la fermeture d'usines prive de nombreuses jeunes femmes de nouvelles opportunités économiques qui leur ont permis de démarrer une vie indépendante. Enfin, les ordonnances de rester à la maison font qu'il est beaucoup plus difficile pour les femmes dans des relations abusives d'échapper à un cycle de violence, ce qui«Pandémie de l'ombre».
 Mais qu'en est-il des femmes handicapées? Les taux d'emploi des femmes handicapées sont les plus bas par rapport aux hommes handicapés et aux hommes et femmes non handicapés. Les jeunes femmes handicapées subissent jusqu'à dix fois plus de violence sexiste que celles non handicapées. Alors, comment la récession économique affectera-t-elle les femmes qui sont déjà exclues de l'éducation et des opportunités d'emploi parce qu'elles ont des besoins différents en matière de communication et d'accès physique? Et comment les pays peuvent-ils garantir que les services offerts aux survivants de violence domestique tiennent compte de la dépendance spécifique des femmes handicapées vis-à-vis de leurs soignants ?
Mais qu'en est-il des femmes handicapées? Les taux d'emploi des femmes handicapées sont les plus bas par rapport aux hommes handicapés et aux hommes et femmes non handicapés. Les jeunes femmes handicapées subissent jusqu'à dix fois plus de violence sexiste que celles non handicapées. Alors, comment la récession économique affectera-t-elle les femmes qui sont déjà exclues de l'éducation et des opportunités d'emploi parce qu'elles ont des besoins différents en matière de communication et d'accès physique? Et comment les pays peuvent-ils garantir que les services offerts aux survivants de violence domestique tiennent compte de la dépendance spécifique des femmes handicapées vis-à-vis de leurs soignants ?
Women, Business and the Law (WBL) a récemment mené une recherche pilote sur les femmes handicapées . Nous essayons de mieux comprendre comment les pays du monde entier utilisent leurs systèmes juridiques pour protéger les femmes handicapées de la discrimination multiple et intersectionnelle à laquelle elles sont confrontées par rapport aux hommes avec et sans handicap. À cet effet, nous avons ajouté quatre nouveaux points de donnéesdans la collecte de données primaires 2020 sur les femmes, les entreprises et le droit. En coopération avec des experts juridiques locaux, nous avons pu mener une évaluation préliminaire pour 176 économies. Cette recherche est la première du genre à cartographier le cadre juridique des droits des femmes handicapées à l'échelle mondiale. Les résultats préliminaires donnent des résultats surprenants: alors que 71 économies ont une disposition constitutionnelle qui garantit l'égalité des droits pour les personnes handicapées, aucune des constitutions analysées ne mentionne les femmes handicapées. En ce qui concerne les lois statutaires, 138 économies ont une loi, autre que la constitution, qui traite des droits des personnes handicapées. Cependant, seul un quart des économies analysées - soit 35 pour être exact - reconnaissent et protègent explicitement les droits des femmes handicapées dans leur cadre juridique.
Par exemple, la loi de 2010 sur les femmes de la Gambie impose l'obligation de «garantir la protection des femmes handicapées et de prendre des mesures spécifiques en fonction de leurs besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l'emploi, à la formation professionnelle et professionnelle, ainsi qu'à leur participation à la prise de décision. » La loi koweïtienne relative aux droits des personnes handicapées de 2010 accorde des prestations de maternité supplémentaires aux femmes handicapées. La Moldavie reconnaît les besoins des femmes handicapées en matière de santé génésique, notamment l'accès aux traitements gynécologiques et aux conseils en matière de planification familiale (loi sur l'inclusion sociale des personnes handicapées de 2012). Et la loi indonésienne sur le handicap de 2016 reconnaît l'importance de protéger les femmes handicapées contre la violence et de fournir des maisons sûres facilement accessibles.
Figure 1: Conclusions préliminaires sur le cadre juridique relatif aux femmes handicapées
Les données pilotes sur les femmes, les affaires et le droit font partie des 10 engagements du Groupe de la Banque mondiale pour un développement intégrant le handicap . À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées de cette année, nous nous engageons à poursuivre nos recherches et à faire en sorte que la voix des femmes handicapées soit entendue par les décideurs du monde entier.
Source: Banque Mondiale
La Tunisie est fréquemment citée comme étant à l'avant-garde des droits des femmes dans le monde arabe en raison du statut unique de la femme tunisienne. Depuis la promulgation du Code du statut personnel (PSC) en 1956, les femmes tunisiennes ont joué un rôle plus important dans le développement du pays. Plus récemment, ils ont joué un rôle essentiel lors de la transition démocratique au lendemain de la révolution.

Depuis que j'ai pris mes fonctions à Tunis, j'ai observé à plusieurs reprises la place importante de la femme tunisienne dans la société et dans le monde professionnel. Un nombre croissant de femmes occupent désormais des postes de direction aux plus hauts niveaux de la fonction publique et du secteur privé. De plus, les indicateurs sont prometteurs: le pays se classe 4e en termes d'égalité hommes-femmes dans la région MENA. Les femmes tunisiennes ont un taux d'alphabétisation de 72%, représentent 42% des étudiants de l'enseignement supérieur et occupent 36% des sièges parlementaires.
Mais se pourrait-il que ces chiffres dissimulent une réalité plus nuancée et dénotent des disparités géographiques et sociales?
Selon le rapport Global Gender Gap 2020, la publication du Forum économique mondial sur les inégalités entre les sexes, sur un total de 153 pays, le classement de la Tunisie en termes d'égalité entre les sexes est passé de la 90e à la 124e entre 2006 et 2020. dans les sous-indices. La Tunisie passe ainsi de la 97ème à la 142ème position en termes de participation économique et d'opportunités de travail, de la 76ème à la 106ème position en termes d'éducation et de la 53ème à la 67ème position en termes de participation politique. Malgré ces performances apparemment bonnes par rapport aux autres pays de la région MENA, la tendance en Tunisie est alarmante, les réalisations sont fragiles et le chemin vers l'égalité reste long.
En effet, si les femmes représentent 67% des diplômés de l'enseignement supérieur, elles ne représentent que 24,6% de la population active. Le chômage touche deux fois plus les femmes (22,5%) que les hommes (12,4%) et cette disparité est encore plus exacerbée dans les régions de l'intérieur du pays (Gabès, Kasserine, Jendouba, Kébili, Gafsa et Tataouine) où le taux de chômage des femmes est à 35% en moyenne. De plus, seuls 23,3% des nouveaux prêts au logement sont accordés aux femmes, et les femmes continuent d'être victimes de violences mondiales, c'est-à-dire d'au moins une forme de violence (physique, sexuelle, psychologique ou économique).
Malgré leurs résultats scolaires, les jeunes femmes souffrent d'une mauvaise intégration dans la vie économique. Le ralentissement des recrutements dans le secteur public, secteur où 39% des effectifs sont des femmes, est un facteur important, mais n'explique qu'en partie cet état de fait. D'autres facteurs entravent l'inclusion économique et l'autonomisation des femmes, comme le manque de systèmes de soutien abordables et de qualité pour les mères qui luttent pour concilier travail et famille, le droit du travail, la violence domestique et la prévalence d'attitudes et de valeurs plus conservatrices que la progressivité de la CFP ne le suggère. Ces inégalités entravent le développement économique et social du pays en le privant d'une partie de ses forces motrices.
La violence contre les femmes est surprenante dans un pays comme la Tunisie. Notre équipe a appris avec consternation que les femmes entrepreneurs de l'intérieur des campagnes ont été la cible d'intimidations et de violences, malgré le fait qu'elles jouissent du droit de transformer les ressources naturelles en produits à haute valeur ajoutée. Grâce à une approche innovante qui combine la tradition des femmes (récoltes artisanales) et l'esprit d'entreprise, ces femmes offrent une opportunité d'inclusion et d'autonomie financière à d'autres femmes rurales. Il est impératif de prévenir les actes de violence pour préserver les droits économiques des femmes et encourager toute une génération de jeunes diplômés de l'intérieur du pays. Les défis de la crise du COVID-19 ne doivent pas mettre en péril les efforts parfois timides d'innovation et d'inclusion économique.
Enfin, le manque d'égalité en termes de droits économiques pénalise les femmes, qui sont fortement désavantagées en termes d'accès au crédit, à la propriété foncière et aux produits financiers. Cette inégalité entrave leurs initiatives entrepreneuriales ou commerciales et affecte leur autonomie financière. Selon le rapport 2020 du Forum économique mondial sur les inégalités entre les sexes, seulement 2,9% des entreprises tunisiennes ont un capital majoritairement féminin. Ainsi, l'importance des garanties dans les décisions de prêt, combinée au code de l'héritage qui prévoit que les femmes n'héritent que de la moitié de la part des hommes du même degré de parenté, sont des obstacles majeurs aux droits économiques des femmes. Nous devons continuer à espérer que le dernier grand projet de feu le Président Essebsi concernant le droit d'héritage se réalisera afin de surmonter cette inégalité fondamentale.
L'énergie, le courage et le dynamisme de la femme tunisienne d'aujourd'hui restent un élément unique dans une région où les inégalités entre les sexes persistent. A l'image de leurs mères et grands-mères qui, dans les années 60 et 70, ont investi dans de nombreux domaines professionnels, que ce soit dans le secteur de la santé ou de l'éducation, dans la fonction publique ou dans les entreprises privées, les jeunes femmes d'aujourd'hui peuvent innover. Ils intègrent les secteurs du futur, les start-up les plus sophistiquées et maîtrisent les métiers les plus sophistiqués. L'Etat tunisien devrait encourager cet esprit d'innovation, en protégeant les femmes de la violence des défenseurs du statu quo, en garantissant leurs droits économiques et en leur offrant l'égalité des chances au travail et à l'école. C'est ça la démocratie.
La Banque Mondiale
Des milliers de filles, au Burkina Faso, en dépit des campagnes de sensibilisation, continuent d’être victimes de l’excision. Plusieurs d’entre elles peinent à mener une vie normale, en raison des séquelles de cette pratique néfaste.

Le 12 février 2011, il était 19 heures. Nathalie (nom d’emprunt), élève en classe de troisième et âgée de 15 ans est pour la première fois à Ouagadougou en provenance du village de Kuzili, dans la commune de Saponé (région du Centre-Sud). Contrairement à ses camarades qui se rendent dans la capitale pour des congés ou des vacances, elle débarque du village par un concours de circonstances.
Dans les faits, deux jours avant son départ du village, Nathalie, de retour de l’école, est appelée par sa grand-mère, Amina. Dans sa chambre, la vieille de 63 ans explique à Nathalie et trois de ses cousines, dont l’âge est compris entre quatre et huit ans, les règles qui régissent la société. La jeune Nathalie est heureuse de “fréquenter l’école” de sa grand-mère. Le temps passe. L’heure des cours de l’après-midi avance.
Les « amies » enchaînent la causerie. Contre toute attente, « Amina, l’exciseuse » lâche : « Après-demain matin, tu seras excisée à nouveau. Vous êtes quatre. Ta première excision a échoué ». Choquée par l’annonce, elle est consolée par sa copine, qui lui conseille de dénoncer Amina aux responsables du village. La jeune fille hésite à dénoncer ses parents. Elle s’est donc résolue à quitter le village, destination, Ouagadougou. « J’avais pris la décision. Je préfère abandonner l’école que de perdre ma vie », explique-t-elle, la voix nouée. Les frais de dossiers pour l’examen du BEPC sont utilisés pour le transport. Arrivée à Ouagadougou à 19 heures, elle est logée chez sa tante, Talato.
« Ma tante a informé ma mère de la situation. Elle a demandé que je sois bien gardée. Quand mon père a su que je vis chez une proche de ma maman, il a divorcé d’elle », témoigne-t-elle, toute furieuse. Espérant reprendre l’école l’année suivante, Nathalie s’exerce à la coiffure auprès de Talato. Son espoir de retrouver le chemin de l’école restera vain. « A la rentrée des classes, ma tante et ma mère n’avaient pas les moyens pour me payer la scolarité à Ouagadougou », laisse entendre l’infortunée.
Agée aujourd’hui de 24 ans, teint clair et mesurant environ 1m 70, Nathalie est désormais coiffeuse. Elle gagne sa vie à travers ce métier. Mais, elle vit les séquelles de la pratique, dans une vie « semi-heureuse » avec son partenaire. « Mon homme est compréhensif et adorable. Mais, le fait que j’ai été excisée me fait souffrir pendant les rapports sexuels. Je ressens des douleurs intenses », narre-t-elle, tête baissée.
Neuf ans après cette tentative de sa seconde excision, les yeux embués de larmes, Nathalie, assise sur une chaise en cette matinée de mardi du mois de juillet 2020, se replonge dans sa douloureuse enfance. En 2002, Nathalie quitte la Côte d’Ivoire pour le bercail. Six mois plus tard, elle subit l’ablation de son clitoris. « On a dit à ma maman, qui est de nationalité ivoirienne, que l’excision est obligatoire pour les filles de notre famille. Et que cela me protègera contre les maladies », confie la demoiselle. « J’ai été excisée à l’âge de six ans. Le clitoris et les petites lèvres ont été coupés.
Je faisais la classe de CP1 », relate-t-elle, en pleurant, la voix à peine audible … Ce triste

jour est le début du calvaire de Nathalie. Elle saigne quand elle urine et est obligée de changer de sous-vêtements en permanence. Son père est complice de son mal. « En classe de CE2, je suis allée en vacances en Côte d’Ivoire. Mon père m’a dit que mon excision avait échoué, car le clitoris a été mal coupé. Il est responsable de la pratique », soutient Nathalie.
La petite Aïcha n’aura pas les mêmes chances que Nathalie. Ce vendredi du mois d’août 2020, une grande pluie s’abat sur Ouagadougou. Nous parvenons à obtenir un rendez-vous avec Dara, la mère de Aïcha. Elle vit dans un quartier populaire de Ouagadougou. Il est 9 heures 30 minutes. Après un soupir, elle questionne : « C’est quelle presse ? Et ma photo ? ». L’anonymat total est réclamé. La confiance s’installe …
Le crime commis sur la petite Aïcha remonte à janvier 2020. Alors que la fillette devait fêter son quatrième anniversaire sept mois plus tard, sa mère est appelée à Done, un village de la commune de Dissin dans la province du Ioba. Raison ? « Honorer une décision ancestrale ». Elle tente d’aller au village mais n’y parvient pas, en raison du coronavirus et la mise en quarantaine des villes comme Ouagadougou. « Je me disais que ma fille était sauvée », dit Dara, toute triste.
Mais, un matin, elle reçoit un appel téléphonique, accompagné de menaces. Elle est accusée de refus de faire venir la petite Aïcha. Un proche de la famille ayant une autorisation les emmène à bord de son véhicule. Aïcha n’échappe pas à son destin. Son clitoris est coupé. « Elle a beaucoup saigné», se remémore la mère de l’infortunée. Après trois jours de soins à 21 heures, « elle est morte dans mes bras », raconte-t-elle, les yeux dégoulinant de larmes.
Le partenaire de Nathalie, O.I., officier de police en service à Ouagadougou compte ester son beau-père en justice. Mais quand ? En attendant, aucune plainte n’est déposée contre le géniteur de Nathalie. Depuis 2016, ce dernier n’est plus rentré au pays. « Quand il va retourner au bercail, nous allons introduire la procédure. Voulez-vous qu’on lance un mandat international contre lui ?», questionne O.I. Pour dame Dara qui confie le sort de la petite Aïcha à Dieu, dénoncer les pratiquants, c’est prendre le risque de devenir persona non grata pour sa belle-famille. Elle se rappelle du cas de sa sœur Angèle (nom d’emprunt) qui a été répudiée par son mari pour avoir signalé un cas d’excision. Cette expérience intimidera dame Dara, qui compte vivre son mal. « Je me dis que c’est la volonté divine. Je pense que c’est mieux de protéger mon foyer », lâche-t-elle.
Nathalie suit un accompagnement psychologique et un traitement dans un centre sanitaire de la place. « Sans ces soins, je serais devenue folle. Il arrive des moments où je revis cet évènement et je me mets à pleurer. Actuellement, je tente de surmonter cette épreuve», confie Nathalie. Ce n’est pas le cas pour dame Dara. Après le deuil de sa fille, elle est revenue à Ouagadougou. Excepté les encouragements du voisinage, elle essaye de vivre avec la douleur. « Suivi psychologique ?
C’est pour les Blancs. J’essaie de confier tout à Dieu », laisse-t-elle entendre. Cependant, l’absence de suivi est dangereuse pour les victimes, selon l’expert de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les mutilations génitales féminines (MGF), Pr Michel Akotionga, par ailleurs vice-président d’honneur du Conseil national de lutte contre la pratique de l’excision au Burkina. Selon lui, il y a quatre types de MGF: le retrait complet du clitoris, le retrait du clitoris et des petites lèvres du sexe, le retrait du clitoris, des petites et des grandes lèvres du sexe afin de rétrécir le sexe et l’étirement des petites lèvres du sexe plus une cautérisation, un percement, une ponction ou une scarification du clitoris par des méthodes chimiques.
Les conséquences sont l’hémorragie, les infections, les troubles psychologiques. « Pour le type II, il y a une cicatrisation vicieuse entrainant l’accolement des lèvres réduisant l’orifice vaginal. Cela peut causer des rapports sexuels douloureux, une rétention des urines et des menstrues », confie le gynécologue, le Pr Akotionga. C’est le cas de S.O.A., victime du type III. Ses nombreuses tentatives d’avoir des rapports sexuels se sont soldées par des échecs. En plus des douleurs, elle doit faire face à la présence de kystes dans son corps. « J’ai 32 ans. Mon vagin a été détruit complètement.
Je sens des douleurs même si mon doigt le touche », explique l’infortunée qui a subi la pratique à l’âge de 17 ans. Pr Akotionga indique qu’une impossibilité de faire les rapports sexuels peut survenir, si l’on est victime de l’excision de type 3 ou 4. Au cas où il y a possibilité, pendant l’accouchement, il y aura des complications. Pour la mère, il peut y avoir des déchirures simples ou compliquées qui peuvent aller jusqu’à l’anus. Cela causera de l’hémorragie et la femme peut en mourir.

Quant au bébé, sa tête pourrait buter contre le périnée qui est devenu dur et peut également mourir. A défaut, l’enfant peut avoir des troubles mentaux. Les prises en charge sont multiples. « Si ce sont des troubles psychologiques qui causent l’insensibilité pendant les rapports sexuels, la victime est conduite chez un psychiatre. Si c’est le rétrécissent du vagin, il y a une sensibilisation pour la rassurer que sa vie sera améliorée. Si un accord est trouvé, nous faisons la réparation et un contrôle est fait chaque semaine jusqu’à la guérison », explique l’expert de l’OMS.
168 cas en 2017 contre 46 en 2016 ; tel est le nombre de filles et de femmes victimes de l’excision, selon l’annuaire statistique 2017 du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Le 20 décembre 2019 s’est tenue la deuxième assemblée générale statutaire du Conseil national de lutte contre la pratique de l’excision.
A l’issue de celle-ci le directeur de cabinet du ministère en charge de la femme, Delwendé Pierre Anselme Nikiema, souligne que 185 filles excisées ont été enregistrées dans la seule région du Sud-Ouest par les services déconcentrés.
Cependant, le Burkina Faso dressera un arsenal contre l’excision. Un numéro vert (80001112) est, dans la foulée, instauré pour les dénonciations. Un plan stratégique national pour l’élimination des MGF, suivi d’un plan d’actions quadriennal 2016-2020 adopté, pour diminuer la pratique. Des éléments juridiques, dont la Constitution dans ses articles 1 et 2 prône respectivement l’égalité des Burkinabè et la protection de l’intégrité physique des citoyens, interdisent les traitements inhumains.
Le Code pénal dont les articles 380 à 382 prévoient des sanctions pénales et financières. Le Code de la famille et des personnes dans son article 510 prévoit des responsabilités parentales. Des traités internationaux et régionaux sont signés. Le Burkina Faso adhère, en 1987, à la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1984.
Le pays des Hommes intègres est champion mondial dans la lutte contre les MGF. Malgré tout, les chiffres sont en hausse.
Selon le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), environ 200 millions de filles et de femmes ont subi des MGF au monde. Et en 2019, environ 4,6 millions ont été excisées.
A cette allure, 68 millions de filles seront victimes de la pratique entre 2015 et 2030.
Sidwaya
Première Dame du Botswana lors de sa tournée à vélo pour STOP à la violence sexiste et marquer la Journée Internationale pour « l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes » à travers le concours d’affiches

Première Dame du Botswana lors de sa tournée à vélo pour STOP à la violence sexiste et marquer la Journée Internationale pour « l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes » à travers le concours d’affiches.
Merck Foundation et la Première Dame du Botswana célèbrent la Journée Internationale de « l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes » en lançant un concours d’affiches pour STOP à la Violence Sexiste. Le 26 novembre 2020, la branche philanthropique de Merck Allemagne, marque la Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes avec l'annonce du concours d'affiches « Stop GBV » en partenariat avec S.E. Mme NEO JANE MASISI, La Première Dame du Botswana et Ambassadrice de ‘Merck More Than A Mother,’ dans le but de prévenir la violence sexiste et la maltraitance des enfants dans le pays.
Merck Foundation CEO, Dr. Rasha Kelej, a rejoint la visite virtuelle à vélo de la Première Dame du Botswana, S.E. Mme NEO JANE MASISI à faire partie de cette initiative créative. « Je crois que c'est la première fois qu'une Première Dame Africaine traverse son pays à vélo pour une cause. C'était également formidable de voir le soutien incroyable du Président du Botswana, S.E. M. MOKGWEETSI MASISI a donné à sa charmante épouse, Première Dame et mère du Botswana, et à nous tous pour éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les filles.
Je salue ma chère sœur, S.E. Mme. NEO JANE MASISI pour ses efforts considérables et son idée novatrice pour mettre fin à la violence sexiste et nous encourager à prendre position contre la violence sexiste et la maltraitance des enfants », a souligné le Dr. Rasha Kelej.
Parlant de l'Initiative « Stop GBV », et avant sa tournée à vélo pour la soutenir, La Première Dame du Botswana S.E Mme. NEO JANE MASISI a déclaré : « La pandémie nous a paralysés, mais elle a également donné lieu à une autre pandémie ; c'est la violence contre les filles, les femmes et les enfants. Les inégalités entre les sexes préexistantes qui alimentent la violence à la maison se sont aggravées en raison des périodes de quarantaine prolongées. L'initiative « Stop GBV » et le concours d'affiches avec Merck Foundation contribueront à nos efforts pour mettre fin à la violence basée sur le genre au Botswana, et nous avons concentré nos efforts conjoints pour lutter contre la violence basée sur le genre, en protégeant l'humanité en particulier les filles et les femmes. La violence sexiste a détruit des familles et nous a empêchés dans la réalisation des objectifs de développement, et a favorisé la désunion au sein des communautés, à la fois au niveau national et international. »
Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and One of the 100 Most Influential Africans (2019, 2020) a souligné : « L'épidémie de coronavirus a aggravé l'impact des problèmes sociaux et culturels existants, qui ont gravement touché les femmes et les enfants, qui ont été enfermés avec leurs agresseurs et sont plus que jamais victimes de violence conjugale. Avec l'initiative « Stop GBV », je me joins à ma sœur, S.E. Mme NEO JANE MASISI, La Première Dame du Botswana, pour soutenir ses grands efforts pour arrêter la violence sexiste et encourager les gens à prendre position contre la violence sexiste et abus sur mineur. »
Le concours d’affiches « Stop GBV » sera l’objectif de la Fondation Merck et de la Première Dame du Botswana de contribuer à l’élimination de la violence sexiste au Botswana.
Le concours d'affiches « Stop GBV » se tiendra dans tout le Botswana et le but du concours est de sélectionner le travail le plus créatif et inspirant en faveur de l'un des principaux objectifs du concours qui sont: Arrêter la violence sexiste, aider les gens à comprendre que la violence sexiste est inacceptable et perverse, promouvoir la tolérance zéro de la violence sexiste et démontrer que la violence sexiste peut être émotionnelle, financière, physique et sexuelle.
Le concours est ouvert aux femmes et aux hommes âgés de 18 à 55 ans, et tous les Batswana, quel que soit leur lieu de résidence, sont éligibles pour participer au concours.
Les candidatures au concours doivent être soumises par e-mail au format fichier (JPG, PNG) à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. en incluant un récit expliquant le message clé sur l'affiche dans le cadre de l'e-mail, et le récit ne doit pas dépasser 200 caractères.
La date de soumission des candidatures au concours d'affiches « Stop GBV » est le 30 novembre 2020.
« La violence à l'égard des filles, des femmes et des enfants continue d'être un problème pressant non seulement en Afrique mais partout dans le monde, et avec l'événement de la Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et le concours d'affiches « Stop GBV » en partenariat avec La Première Dame du Botswana, nous espérons apporter un changement dans nos sociétés et faire comprendre que la prévention de la violence sexiste est un droit humain fondamental », a ajouté le Dr. Kelej.
Distribué par APO Group pour Merck Foundation.
Québec, le 11 novembre 2020. Femmessor a procédé au dévoilement des 100 entrepreneures qui feront partie de la campagne ayant pour thème « La force de l’impact » présentée par RBC. Cette toute nouvelle campagne offrira un rayonnement sans précédent à 100 femmes issues de tous les horizons et provenant des 4 coins du Québec qui ont une influence positive sur notre société, et dont l’entreprise répond à au moins un des 17 objectifs de développement durable fixés par l’ONU pour créer un monde meilleur.

« Avec cette campagne, nous voulons mettre de l’avant des entrepreneures d’exception qui contribuent à la création d’un monde meilleur, mais aussi créer un vaste mouvement afin d’inspirer d’autres entrepreneures à passer à l’action. Par le biais de cette campagne, Femmessor se positionne non seulement comme une organisation de soutien à l’entrepreneuriat féminin, mais comme leader de changement dans le Québec de demain, en prônant un nouveau modèle économique plus résilient et plus respectueux des humains et de l’environnement » mentionne Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.
« J’ai été ravie de voir autant d’entrepreneures pleinement engagées dans l’atteinte des objectifs de développement durable. Je suis fière de faire partie de cette campagne, qui permet de donner une voix et mettre sous les projecteurs des femmes de tête qui ont à cœur un monde meilleur. J’en profite pour remercier les membres du jury, qui ont fait un travail remarquable et surtout, félicité toutes les entrepreneures qui ont déposé leur candidature » ajoute Danièle Henkel, présidente du jury de la campagne.
Initiée par Femmessor et présentée par la RBC, en collaboration avec Coup de pouce, TVA Publications, QUB radio, Lavery, Janie Duquette & l’Académie du pouvoir féminin, Lazuli marketing conseil, le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec ainsi que le gouvernement du Canada, la campagne permettra aux 100 entrepreneures choisies de bénéficier d’une grande visibilité. En effet, les profils des entrepreneures seront présentés sur le site de Femmessor, les profils vidéo seront diffusés dans les médias sociaux, en plus de plusieurs opportunités de rayonnement via des entrevues médiatiques, des billets de blogue, des parutions dans un bookazine et plus encore ! Cette visibilité de grande envergure se déploiera de décembre 2020 à mars 2021.
Liste des 100 entrepreneures de la campagne(le lien est externe)
À propos de Femmessor
Femmessor est une organisation dédiée au développement de l’entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l’acquisition d’entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec. Son offre de financement conjuguée à une expérience d’accompagnement adapté aux besoins des entrepreneures permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères. Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à un partenariat avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Femmessor, Fondaction, Investissement Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec), elle facilite l’accès à près de 19 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions et des votes.