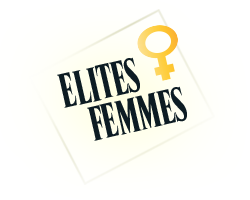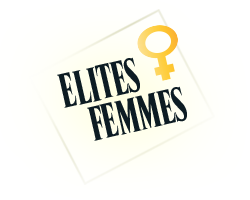
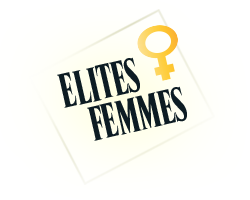
|
EDITORIAL
|
|
Une approche globale de la société : le rôle des femmes est essentiel pour bâtir des communautés résilientes après le Covid-19 (Par Vanessa Moungar et Yero Baldeh)
 |
|
La pandémie a eu un impact disproportionné sur les femmes et les filles vivant dans des environnements fragiles
|
|
ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 12 novembre 2020/ -- Par Vanessa Moungar et Yero Baldeh *
Dans le contexte de fragilité que connaît l’Afrique, ce sont les groupes déjà marginalisés qui ploient le plus sous le fardeau des conflits, de la pauvreté et du changement climatique. Si nous ne redoublons pas d’efforts collectivement, les pauvres représenteront plus de 90 % de la population africaine d’ici à 2030. Triste record, huit des dix pays les plus pauvres du monde se trouveront sur le continent, en situation de grande fragilité. Il nous faut agir d’une manière décisive pour modifier cette tendance. Aujourd'hui, des poches de fragilité se propagent de plus en plus dans les pays africains mais également au-delà de leurs frontières, exacerbées par l'épidémie de Covid-19 avec ses conséquences sanitaires économiques et sociales. La pandémie a eu un impact disproportionné sur les femmes et les filles vivant dans des environnements fragiles , compromettant, entre autres, leur éducation, leurs moyens de subsistance et leur nutrition. N’oublions pas que les femmes sont les piliers des économies africaines. Moteurs clés de la transformation, elles peuvent nous aider à reconstruire des sociétés meilleures et plus résilientes. Ne nous trompons pas : ce sont les femmes qui peuvent aider à reconstruire les communautés une fois la crise passée. Mais à la condition d’être autonomisées et de recevoir un soutien adéquat. Des études démontrent qu'en Afrique, les femmes réinvestissent jusqu'à 90% pour assurer un filet de sécurité sociale à leurs familles, ce qui a des répercussions positives sur la santé, l'éducation et la nutrition. Investir en faveur des femmes, c’est s’assurer des rendements plus élevés. Les défis de la vulnérabilité et de la fragilité La fragilité et ses manifestations sont complexes, multidimensionnelles et évolutives en raison des changements sociaux, économiques, politiques et environnementaux dramatiques qui exacerbent les inégalités, l'exclusion et la marginalisation. Les femmes ont été pendant bien trop longtemps – et le sont malheureusement encore trop souvent – réduites à des tâches bénévoles ou des emplois mal rémunérés, avec pour résultat des sources de revenus et de protection sociale imprévisibles et inadéquates. La crise du Covid-19 a aggravé ces inégalités. Une étude, réalisée en juillet 2020 par ImpactHer et ONU Femmes (https://bit.ly/2Iv4ONX) dans 30 pays africains, a révélé que 80% des femmes propriétaires de PME avaient dû fermer temporairement ou définitivement leur entreprise en raison des restrictions sanitaires. L’effet du ralentissement économique, subi par les entreprises dirigées par des femmes, se fait sentir dans toute la société car ces entreprises représentent environ 40% des PME africaines. La réduction de l'accès aux services de base qui en a résultée a eu un effet domino dévastateur sur la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l'éducation et le logement, pour ne citer que quelques-unes des pressions croissantes qu’exerce la fragilité sur tout le continent. Qui plus est, les marges de manœuvre budgétaire des gouvernements se réduisent à cause de la baisse d’activité et des répercussions budgétaires croissantes des appels à une protection sociale accrue pour faire face à la pandémie. Le financement du développement devient ainsi la dernière préoccupation des gouvernements. Les femmes peuvent stimuler la résilience Les femmes sont au cœur de nos économies et de nos sociétés. Leur ouvrir plus d'opportunités se traduira ainsi par des impacts démultipliés pour tous. Donnez de l’autonomie aux femmes et donnez-leur le soutien qu’elles méritent, les communautés en seront transformées, plus inclusives et fortes d’une prospérité partagée. Oui, réduire la pauvreté est possible sur le continent africain ! La Banque africaine de développement est aux avant-postes pour relever le double défi de soutenir les populations plus vulnérables et de renforcer la résilience des communautés en Afrique. Avec nos partenaires, nous nous efforçons de résoudre certaines des causes profondes de la fragilité et de la vulnérabilité des femmes, des jeunes et d'autres groupes marginalisés tels que les personnes déplacées de force et leurs communautés d'accueil, au moyen de politiques stratégiques clés faciles à mettre en oeuvre. Et pour y arriver, nous nous appuyons sur de nombreux travaux et outils analytiques ou de savoir, qui sous-tendent toutes nos stratégies, politiques et opérations en Afrique. La Banque soutient, par exemple, les activités génératrices de revenus au Sahel, dans des zones telles que Tombouctou au Mali, Diffa et Agadez au Niger et Kishira au Tchad, afin de briser les cycles de crise et de vulnérabilité à long terme. Si la réactivité et la flexibilité guident l’approche du Groupe de la Banque africaine de développement pour lutter contre la fragilité, il convient de mettre davantage l’accent sur l’alerte précoce des risques, les efforts d’atténuation et de prévention. Partenariats innovants Si une grande partie du terrain a été balisé, il reste néanmoins de nombreux défis à relever. Et ils ne pourront l’être que dans une approche intégrée de tous les secteurs. Ce n’est qu’à cette condition qu’on pourra identifier les interventions spécifiques requises ou mesurer les performances et en rendre compte. Dans cette perspective, les partenariats innovants ont une importance capitale pour briser les silos des actions de développement et des interventions humanitaires alors même qu’elles font partie de la famille élargie « paix – développement – humanitaire ». En nous ouvrant au secteur privé tout en tirant parti de nos avantages comparatifs, nous pouvons amplifier notre impact sur le terrain et briser le cycle de la pauvreté et de la fragilité. Certains des moyens les plus efficaces d'investir dans la résilience des femmes, des jeunes et des communautés vulnérables font l’objet de discussions au sommet « Finance en Commun » qui se tient les 11 au 12 novembre en mode virtuel. C’est le cas notamment de la session de haut niveau intitulée « Sécurité humaine dans les contextes fragiles : intensification des investissements humanitaires et de résilience » ou encore de la session sur « Les banques de développement en tant qu'acteurs du changement vers l'égalité des sexes ». Le sommet rassemble, pour la première fois, 450 banques publiques de développement dans le but de promouvoir de nouvelles formes d'investissement pour favoriser une croissance inclusive et durable. Rejoignez-nous en ligne (https://FinanceinCommon.org). Le moment est venu d'investir en faveur des femmes, de valoriser leur force et leur résilience afin de bâtir des communautés plus prospères. Car lorsque les femmes réussissent, leur succès profite au plus grand nombre ! * Vanessa Moungar est directrice en charge du genre, femmes et société civile à la Banque africaine de développement * Yero Bladeh est directeur du bureau de coordination des états en transition à la Banque africaine de développement Distribué par APO Group pour African Development Bank Group (AfDB).
|
|
Sommet Finance en commun : « La priorité post-Covid pour l’Afrique, c’est la création d’emplois, la promotion des femmes et le financement de l’infrastructure, en respectant l’environnement », déclare Adesina
|
|
Les investissements des banques publiques de développement devraient cibler les femmes qui ont un rôle majeur à jouer dans le développement du continent |
|
ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 12 novembre 2020/ -- Akinwumi A. Adesina, président de la Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org/) a pris part ce matin à la conférence de presse du Sommet « Finance en commun », organisé les 11 et 12 novembre 2020, en marge du Forum de Paris pour la paix. S’exprimant aux côtés de Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de développement, Adesina a défini les grandes priorités de l’Afrique à l’ère post-Covid-19 : financer l’infrastructure, créer des emplois et investir dans les femmes. Distribué par APO Group pour African Development Bank Group (AfDB). |
La cheffe économiste du Fonds monétaire international (FMI) Gita Gopinath fait partie des femmes de l'année 2020 distinguées par l'édition indienne du prestigieux magazine Vogue, dont elle est en couverture de l'édition du 9 novembre selon le journal en ligne notretemps.com.

Gita Gopinath, Indo-américaine de 48 ans, a été élue leader d'opinion mondiale par l'édition indienne de Vogue.
Elle est la première femme à occuper ce poste au sein de l'institution économique, et avait pris ses fonctions en janvier 2019, un an avant que la pandémie de Covid-19 ne bouleverse l'économie mondiale, provoquant une crise sans précédent.
Depuis, elle appelle régulièrement les pays à dépenser pour aider l'économie à se relever et soutenir les populations, et déplore l'accroissement des inégalités.
"Certaines décisions ne peuvent plus être repoussées. Une reprise plus verte est nécessaire pour prévenir les risques catastrophiques liés au changement climatique. À l'avenir, le monde doit être moins inégalitaire, avec un accès universel à l'éducation, aux soins de santé et aux filets de sécurité sociale", plaide ainsi Mme Gopinath dans Vogue.
Elle y parle également de son enfance en Inde, ou encore de son mari et de son fils de 17 ans.
Avant le FMI, Gita Gopinath était professeure d'économie à l'Université d'Harvard.
La Rédaction
La marque Apple a présenté mardi 10 novembre trois nouveaux modèles d'ordinateurs équipés de ses propres puces: ses deux ordinateurs portables les plus populaires, le MacBook Air et le MacBook Pro avec un écran de 13 pouces, et l'ordinateur de bureau Mac Mini lit-on dans le colonnes de notre confrère lesechos.fr.

Dans une vidéo filmée depuis son siège de Cupertino, Tim Cook et ses équipes ont présenté trois nouveaux modèles de Mac équipés de M1, sa puce conçue en interne : ses deux ordinateurs portables les plus populaires, le MacBook Air et le MacBook Pro avec un écran de 13 pouces, et l'ordinateur de bureau Mac Mini. « M1 est la puce la plus puissante que nous avons jamais créé, elle rend les ordinateurs radicalement plus rapides, améliore la durée de vie de la batterie et permet de faire tourner plus de logiciels que jamais sur le Mac », a vanté le PDG d'Apple.
L'entreprise compte développer « une famille de puces » pour l'ensemble de sa gamme d'ordinateurs. Une « transition qui se fera sur les prochaines années », a indiqué John Ternus, le vice-président en charge du hardware, plus prudent qu'en juin, où la firme à pomme avait indiqué que celle-ci prendrait deux ans.
La Rédaction
Avant la pandémie de COVID-19, les pays émergents et les pays en développement ont connu deux décennies de croissance constante, qui leur ont permis de faire des progrès indispensables dans la réduction de la pauvreté et l’allongement de l’espérance de vie. La crise actuelle risque de remettre en cause une grande partie de ces progrès et d’accélérer le creusement des inégalités entre les riches et les pauvres.

Avant la pandémie, beaucoup de ces pays sont certes parvenus à réduire la pauvreté et à allonger l’espérance de vie, mais ils ont eu du mal à faire baisser les inégalités de revenus. Dans le même temps, une grande partie de la jeunesse de ces pays est restée durablement plongée dans l’inactivité, c’est-à-dire sans emploi, éducation, ni formation ; les inégalités en matière d’éducation sont considérables, et beaucoup reste à faire pour améliorer les perspectives économiques des femmes. La COVID-19 va sans doute creuser ces inégalités encore davantage que les crises précédentes, car les mesures mises en œuvre pour enrayer l’épidémie touchent de manière disproportionnée les travailleurs précaires et les femmes.
Dans la dernière édition de nos Perspectives de l’économie mondiale, nous avons cherché à mesurer les effets de la pandémie sur les inégalités à l’aune de deux variables : la capacité d’un individu à travailler depuis son domicile, et la contraction attendue du PIB dans la plupart des pays du monde.
Importance du lieu de travail
Premièrement, on ne saurait négliger l’importance de la capacité à télétravailler à domicile au cours de la pandémie. Une récente étude du FMI montre que les travailleurs à faible revenu ont moins de possibilités de travailler depuis chez eux que les personnes qui ont des revenus élevés. Les données américaines font apparaître que les secteurs d’activité les plus propices au télétravail à domicile ont connu des baisses d’effectifs moins importantes. Il découle de ces deux observations que les travailleurs à faible revenu ont moins de chances de pouvoir travailler depuis chez eux, et risquent davantage de perdre leur emploi à cause de la pandémie : les inégalités de revenus pourraient donc se creuser.
Deuxièmement, pour estimer la baisse globale des revenus, nous avons choisi d’utiliser les prévisions du FMI pour croissance du PIB en 2020 comme indicateur de substitution. Nous avons alors réparti les pertes de revenus en proportion de la capacité à travailler depuis le domicile dans chaque tranche de revenus. À partir de cette nouvelle répartition, nous avons calculé la valeur post-COVID d’un indicateur synthétique de distribution des revenus (coefficient de Gini) pour l’année 2020 dans 106 pays, puis nous avons calculé la variation en pourcentage de cet indicateur. Plus le coefficient de Gini est élevé, plus les inégalités sont grandes : les personnes ayant des revenus élevés reçoivent une proportion beaucoup plus importante du revenu total de la population.
Ce calcul montre que la COVID-19 devrait avoir des effets beaucoup plus importants sur la répartition du revenu que les pandémies précédentes. Il révèle en outre que les gains économiques enregistrés par les pays émergents et les pays en développement à faible revenu depuis la crise financière mondiale risquent d’être perdus. D’après cette analyse, le coefficient de Gini moyen pour les pays émergents et les pays en développement va augmenter jusqu’à 42,7, c’est-à-dire à un niveau proche de ce que l’on observait en 2008. Les répercussions seraient plus marquées dans les pays en développement à faible revenu en dépit de progrès plus lents depuis 2008.
Le bien-être des populations est menacé
Cette tendance générale à l’augmentation des inégalités a des effets notables sur le bien-être des individus. Pour mesurer les avancées réalisées en matière de bien-être avant la pandémie et pour chercher à savoir à quoi s’attendre en 2020, nous avons utilisé un indicateur plus large que le PIB. Cet indicateur de bien-être synthétise des informations relatives à l’augmentation de la consommation, à l’espérance de vie, au temps libre et aux inégalités en matière de consommation. Ces mesures montrent qu’entre 2002 et 2019, les pays émergents et les pays en développement ont connu une augmentation de leur bien-être de presque 6 %, soit 1,3 point de pourcentage de plus que la croissance réelle du PIB par habitant, ce qui semble indiquer que de nombreux aspects de la vie des individus se sont améliorés au cours de cette période. Cette augmentation tient principalement à l’allongement de l’espérance de vie.
La pandémie pourrait entraîner une baisse du bien-être de 8 % dans les pays émergents et dans les pays en développement ; plus de la moitié de cette baisse serait la conséquence de l’augmentation excessive des inégalités liée à la possibilité ou non des individus de travailler depuis leur domicile. Il est à noter que ces estimations ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures de redistribution du revenu qui seraient prises après la pandémie. En d’autres termes, les pays peuvent prendre des mesures pour atténuer les effets sur les inégalités et le bien-être plus généralement.
Que faire ?
Pour empêcher les inégalités de se creuser davantage, il est indispensable de mettre en œuvre des mesures d’aide aux individus et aux entreprises touchés, dont certaines figurent dans la dernière édition de nos Perspectives de l’économie mondiale.
En investissant dans des programmes de formation et d’acquisition de nouvelles compétences, il est possible d’améliorer les perspectives de retour à l’emploi des travailleurs dont les tâches risquent de se modifier durablement en raison de la pandémie. En parallèle, à l’heure où le numérique occupe une place de plus en plus importante dans le monde du travail, il faut élargir l’accès à internet et favoriser l’inclusion financière.
L’assouplissement des conditions donnant droit à l’indemnisation du chômage et l’octroi de davantage de congés parentaux et de congés maladie peuvent également atténuer les effets de la crise sur l’emploi. Il faut se garder de mettre fin prématurément à l’aide sociale versée sous la forme de transferts monétaires conditionnels, de bons alimentaires, de programmes d’aide nutritionnelle et de prestations médicales.
Pour bâtir un avenir plus équitable et plus prospère après la crise, il sera crucial de prendre des mesures qui permettent d’éviter d’effacer les gains durement acquis au cours des dernières décennies.
Ce blog s’appuie sur les résultats de travaux réalisés dans le cadre d’un partenariat de recherche sur la politique macroéconomique dans les pays à faible revenu, qui a bénéficié du soutien du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) britannique. Le présent document ne reflète pas nécessairement le point de vue du FCDO.
*****
Gabriela Cugat est économiste au département des études du Fonds monétaire international. Ses travaux de recherches portent notamment sur la macroéconomie internationale, ainsi que sur l’hétérogénéité et les inégalités entre les ménages. Elle est titulaire d’un doctorat de la Northwestern University et travaille pour le FMI depuis 2019.
Futoshi Narita est économiste principal au département des études du FMI. Ses recherches concernent notamment la macroéconomie, la finance et le développement, et en particulier l’utilisation de données microéconomiques et atypiques à des fins d’analyse macroéconomique. Il a reçu son doctorat en sciences économiques à l’Université du Minnesota, et a rejoint le FMI en 2011. Il a occupé des postes au département financier, au département Afrique, ainsi qu’au département de la stratégie, des politiques et de l’évaluation du FMI.
Gabriela Cugat et Futoshi Narita
FMI
En période de Covid-19 et de restrictions de mobilité imposées dans de nombreux pays en développement, les services financiers numériques (DFS) peuvent remplir une fonction importante en permettant la distribution des transferts sociaux et des paiements d'envoi de fonds et en fournissant un moyen de paiement. Pourtant, les SFN et les autres services financiers ne sont pas facilement accessibles à tous.

Un rapport récent préparé pour le Partenariat mondial du G20 pour l'inclusion financière (GFPI) se concentre sur l'importante question des écarts entre les sexes dans l'accès au financement. Si des progrès ont été réalisés et que 240 millions de femmes de plus ont des comptes bancaires ou d'argent mobile qu'en 2014, les femmes sont toujours toujours désavantagées pour accéder aux services financiers (Findex, 2017).
En Afrique subsaharienne, les femmes sont 11 points de pourcentage moins susceptibles d'avoir un compte selon le Findex 2017. Dans le monde, 980 millions de femmes n'ont toujours pas de compte dans une institution financière (Findex, 2017). Les femmes sont également 20% moins susceptibles d'avoir un compte d'argent mobile (GSMA, 2019).
Qu'est-ce qui explique cet écart? Bien que des facteurs tels que la moindre possession de téléphone, l'alphabétisation et le manque de fonds et de documentation chez les femmes soient connus pour contribuer aux disparités entre les sexes, des questions restent sans réponse concernant le rôle du genre dans l'adoption et l'utilisation des DFS (voir cet article de notre collègue Leora Klapper) . Un nouveau document de recherche comble certaines de ces lacunes et cherche à comprendre le rôle du sexe de l'agent dans les décisions de transaction.
Dans l'étude, nous fournissons de nouvelles preuves à l'appui des options politiques proposées dans le rapport du GFPI. Notamment,
Nous avons collaboré avec FINCA DRC, une institution de microfinance en République démocratique du Congo (RDC) pour enquêter sur l'importance du genre dans les transactions DFS. Nous avons cherché à répondre à quelques questions simples: les femmes préfèrent-elles traiter avec des femmes agents? Traitent-ils des montants plus importants avec des femmes agents? Et iraient-ils même plus loin pour traiter avec une femme agent? Pour répondre à ces questions, nous avons analysé un ensemble de données complet de plus d'un million de transactions clients (couvrant toutes les transactions bancaires des agents de l'établissement entre avril 2017 et mars 2018).
Le réseau d'agents et la clientèle de FINCA sont dominés par des hommes, comme c'est le cas pour de nombreuses institutions de microfinance. Environ 39% des clients et 23% des agents sont des femmes. Les transactions entre clients masculins et agents masculins représentent la majorité (56%) de toutes les transactions dans les données (et 66% du volume des transactions). Dans les différents endroits (zones de marché) où FINCA est présente, il y a toujours des femmes agents, mais leur part peut être assez faible (la part des femmes agents sur un marché varie de 7% à 34%).
Nous utilisons une analyse de régression pour analyser l'effet du sexe de l'agent sur le comportement des transactions au niveau individuel, en tenant compte de l'emplacement de l'agent, de l'âge du client, de l'âge de l'agent, du type de transaction, du montant de la transaction et de la devise (qu'il s'agisse de dollars américains ou de francs congolais, en tant qu'agents FINCA). peuvent effectuer des transactions dans l'une ou l'autre devise). Les résultats suivants émergent:
Les résultats de la RDC montrent que le sexe de l'agent est important pour la manière dont les clients utilisent DFS. Nous reproduisons ces résultats avec un ensemble de données plus petit d'un essai contrôlé randomisé au Sénégal et trouvons les mêmes tendances. Bien que ces résultats doivent encore être validés dans d'autres contextes en Afrique subsaharienne et au-delà, ils suggèrent des moyens par lesquels l'adoption et l'utilisation des services financiers par les femmes peuvent être accélérées:
Les résultats montrent que le comportement des transactions DFS est influencé par le sexe de l'agent. Comprendre les modèles d'utilisation tenant compte du genre peut contribuer à faire progresser l'inclusion financière des femmes. Nous espérons voir plus de recherches sur les modèles d'utilisation des DFS par les femmes, pour éclairer la conception, la mise en œuvre et la fourniture de services et de politiques financiers qui répondent aux besoins des femmes et les répondent.
Le soutien à cette recherche a été fourni par le Partenariat IFC-Mastercard Foundation pour l'inclusion financière et la Banque mondiale. Le document de recherche complet est disponible ici .
Banque Mondiale
C'est la consécration d'une carrière hors normes: Kamala Harris, ancienne procureure et fille d'immigrés, entre dans l'Histoire comme la première femme à accéder à la vice-présidence des Etats-Unis.

A 56 ans, la dynamique et pugnace sénatrice de Californie a permis à Joe Biden, 77 ans, d'engranger les voix d'un électorat plus divers qui avait soif de se voir mieux représenté au sommet du pouvoir. A tel point que certains électeurs disaient voter non pas pour M. Biden mais pour elle, la fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne.
Pendant la campagne, celle qui sera aussi la première personne noire à devenir vice-présidente du pays, a appelé sans relâche à une mobilisation historique des femmes et des minorités, en dénonçant les tentatives d'entraver le scrutin dans des Etats républicains.
"Pourquoi croyez-vous que tant de gens puissants (...) essayent de vous empêcher de voter", a-t-elle demandé en Géorgie, l'un des Etats-clés de l'élection. "Ils connaissent votre pouvoir", a-t-elle répondu. "Ne laissez personne vous mettre hors-jeu."
Arborant toujours un masque contre le coronavirus et respectant les distances de précaution comme Joe Biden, elle a mené une campagne plus active que le septuagénaire, dansant au rythme des fanfares ou s'entretenant avec les clients de cafés... en extérieur, pandémie oblige.
Elle a aussi rencontré à Milwaukee la famille de Jacob Blake, un homme noir grièvement blessé par la police, en pleine vague de colère historique contre le racisme aux Etats-Unis.
- Pionnière -
Forte d'un parcours brillant, digne du meilleur rêve américain malgré des chapitres controversés, elle rêvait de devenir la première femme présidente noire des Etats-Unis.
Elle a finalement brigué la vice-présidence mais avec, sans doute, un oeil sur la présidentielle de 2024 et l'espoir de briser, alors, l'ultime plafond de verre.
Kamala Harris accumule déjà les titres de pionnières.
Elle a grandi à Oakland, où ses parents - un père professeur d'économie et une mère, aujourd'hui décédée, chercheuse spécialiste du cancer du sein - militaient pour les droits civiques.
Diplômée de l'université Howard, fondée à Washington pour accueillir les étudiants afro-américains en pleine ségrégation, elle rappelle régulièrement son appartenance à l'association d'étudiantes noires "Alpha Kappa Alpha".
Après deux mandats de procureure à San Francisco (2004-2011), elle avait été élue, deux fois, procureure générale de Californie (2011-2017), devenant alors la première femme, mais aussi la première personne noire, à diriger les services judiciaires de l'Etat le plus peuplé du pays.
Puis en janvier 2017, elle avait prêté serment au Sénat à Washington, s'inscrivant comme la première femme originaire d'Asie du Sud et seulement la deuxième sénatrice noire dans l'histoire.
Ses interrogatoires serrés de candidats présidentiels à des postes que le Sénat doit confirmer l'ont depuis fait connaître, comme face aux juges nommés à la Cour suprême Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett.
Pendant la primaire démocrate, elle avait d'ailleurs promis de "mener le réquisitoire" contre Trump.
- "Monstre" -
Mais lors d'un des débats, c'est contre Joe Biden qu'elle avait fait des étincelles, en l'attaquant sur ses positions passées concernant les politiques de déségrégation raciale dans les années 1970.
En racontant comment, petite fille, elle était dans l'un des bus amenant les écoliers noirs dans les quartiers blancs, elle avait ému, et bondi brièvement dans les sondages.
Peinant à définir clairement sa candidature, elle avait toutefois jeté l'éponge.
Ses expériences dans les branches législative, judiciaire et exécutive du pouvoir, et sa proximité avec Beau Biden, fils de Joe et ancien procureur du Delaware décédé d'un cancer en 2015, ont malgré tout convaincu son ex-rival de la choisir comme colistière.
Il compte aussi sur son image moderne de femme se présentant en "Momala", fière de sa famille mixte et recomposée. Son époux, l'avocat blanc Douglas Emhoff, a lui aussi participé activement à la campagne présidentielle.
Mais son passé de procureure pèse aussi contre elle. Des électeurs noirs et progressistes déplorent sa réputation de dureté, notamment en punissant strictement de petits délits qui ont, selon ses détracteurs, affecté surtout les minorités.
Face à Mike Pence, dans le seul débat des vice-présidents, elle avait attaqué à de multiples reprises la gestion par l'exécutif de la crise du coronavirus, qu'elle a qualifiée de "plus gros échec de toute administration présidentielle dans l'histoire" du pays.
Le lendemain, Donald Trump l'avait traitée de "monstre" qui ne dit que "des mensonges". Il n'a de cesse de mettre en garde contre ses opinions, qui feront, selon lui, plonger l'Amérique dans un "socialisme" honni.
elc/iba/cjc
|
La plateforme Chinagoods trouve son origine dans la tendance vers la transformation numérique de Yiwu Commodities City
 |
|
YIWU CITY, Chine, 9 novembre 2020/ -- Le site Internet officiel du marché de Yiwu – http://www.Chinagoods.com/ – a été lancé officiellement le 21 octobre. Développée et exploitée par Yiwu China Commodities City, la plateforme Chinagoods est au service de 2 millions de petites et micro-entreprises en amont de la chaîne industrielle, avec comme ressource 75 000 commerces physiques sur le marché de Yiwu. Depuis le début des tests en ligne en avril de cette année, la plateforme a été installée chez plus de 50 000 commerçants et plus de 500 000 acheteurs se sont inscrits.
Orientée données, la plateforme Chinagoods met en relation l'offre et la demande aux niveaux de la conception de production, de la diffusion et des transactions, de l'entreposage logistique, du crédit financier et d’autres aspects. Elle intègre des services en ligne, des expositions et des transactions en ligne, le dédouanement pratique, la logistique d'information, l'entreposage numérique, des services pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, la collecte de données de crédit et les demandes de crédit, l'autonomie financière de la chaîne d'approvisionnement et d’autres fonctions pour construire un système de cadre “entité de marché + plateforme commerciale + plateforme de service + infrastructure”, qui offre des services d’activités de marché ponctuels, efficaces, pratiques et intégrés. La plateforme Chinagoods trouve son origine dans la tendance vers la transformation numérique de Yiwu Commodities City. Basée sur le système d’exploitation de marché physique mature, elle ouvre un nouveau chapitre du développement de marché en s’efforçant de donner toute sa place aux avantages globaux en ressources du marché des produits de base de Yiwu, intégrant la chaîne industrielle de manière transparente et efficace et donnant aux échanges commerciaux sur les marchés traditionnels de nouvelles formes et connotations pour offrir un avenir radieux au développement commercial de Yiwu via une nouvelle forme de commerce électronique. Site Internet officiel du marché de Yiwu : http://www.Chinagoods.com/ Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Distribué par APO Group pour Yiwu Market.
|
|
Le directeur de Google pour l'Afrique subsaharienne, Nitin Gajria, rejoint le panel de juges le plus important et le plus influent jamais réuni pour un prix de journalisme en Afrique
 |
|
Le panel de juges du Prix APO Group de la Journaliste Africaine est composé de 100 sommités, avec des icônes mondiales telles que Naomi Campbell et des dirigeants de diverses organisations comme Twitter, Canon, la NBA, Microsoft, FIFA, Dangote et bien d'autres
|
|
LAUSANNE, Suisse, 9 novembre 2020/ -- APO Group (www.APO-opa.com), le leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, est ravi d'annoncer que le directeur de Google pour l'Afrique subsaharienne, Nitin Gajria, rejoint le jury du prix APO Group African Women in Media Award 2020 (Prix APO Group de la Journaliste Africaine : http://bit.ly/APOawardFR). Le Prix récompense, valorise et met à l’honneur des journalistes africaines soutenant l’entrepreneuriat féminin en Afrique.
Plus de 100 personnalités de diverses organisations se sont réunies pour faire de ce panel de juges le plus important et le plus influent jamais réuni pour un prix de journalisme en Afrique. APO Group a rassemblé 100 personnalités, avec des icônes mondiales telles que Naomi Campbell, rejoints par des cadres supérieurs de tous les principaux secteurs du continent, de Visa à Hilton; Facebook à World Rugby; et Uber à LEGO ! Téléchargez la liste au format Word : www.bit.ly/APOjudges Nitin Gajria dirige la région Afrique subsaharienne chez Google. Il travaille dans l'entreprise depuis plus de six ans, après avoir passé plus d'une décennie dans le marketing de marque chez Procter & Gamble et Mead Johnson travaillant dans toute la région Asie-Pacifique. Avant d'occuper son poste actuel, Nitin dirigeait les activités de YouTube en Inde et en Asie du Sud-Est et il a également dirigé Google au Vietnam, au Cambodge et au Laos. Nitin a un vif intérêt pour les start-ups technologiques et est lui-même un business angel. Il est originaire de Mumbai en Inde, a terminé ses études à Kolkata, en Inde et a également vécu et travaillé à Sydney et à Singapour. Il vit avec sa famille à Johannesburg depuis 19 ans. « Ce prix suscite un élan sans précédent et nous sommes ravis que Nitin rejoigne le jury », a déclaré Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et président d’APO Group (www.Pompigne-Mognard.com). « Cette année, nous avons plus de 100 juges… et nous continuons à en accueillir des nouveaux ! Mais, plus important que cela, chaque membre du panel de juges est un leader dans son domaine, et tous partagent notre passion visant à soutenir le journalisme féminin et l'entrepreneuriat en Afrique. Ce jury réellement exceptionnel nous a aidé à faire du prix APO Group African Women in Media Award le plus important et le plus prestigieux prix de journalisme en Afrique. » Le prix APO Group African Women in Media Award 2020 (Prix APO Group de la Journaliste Africaine) fait partie de l’engagement d’APO Group à soutenir le développement du journalisme sur le continent. Le prix est ouvert aux femmes journalistes africaines dont les reportages ont été diffusées ou publiées entre le 1er janvier et le 31 octobre 2020. Les candidatures seront évaluées en fonction de leur contenu, du style, de la qualité d’analyse, de la créativité, de la dimension humaine et de l’impact sur la communauté. Les juges seront invités à sélectionner la journaliste gagnante, qui sera ensuite annoncée lors de la 6e Conférence virtuelle et récompenses du 6e Forum africain sur l'innovation et l'entrepreneuriat des femmes (AWIEF) (AWIEForum.org), organisée du 2 au 3 décembre 2020, avec le thème « Reimagining Business & Rebuilding Better ». Le prestigieux événement annuel de l’AWIEF se veut une plateforme permettant à des leaders d’opinion, des experts de l’industrie, des décideurs politiques, des intellectuels, des organisations de développement et des investisseurs du monde entier de se rencontrer pour échanger, tisser des liens, partager des idées, collaborer et négocier dans un effort commun de stimulation de l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin en Afrique. APO Group
|
Financement, mentorat et accompagnement… Ce sont autant de mécanismes de soutien mis en place par Future Female Invest (FFI) à l’intention des entrepreneuses à travers l’Afrique. L’objectif de cette plateforme est de les aider à assurer la croissance durable de leurs entreprises.
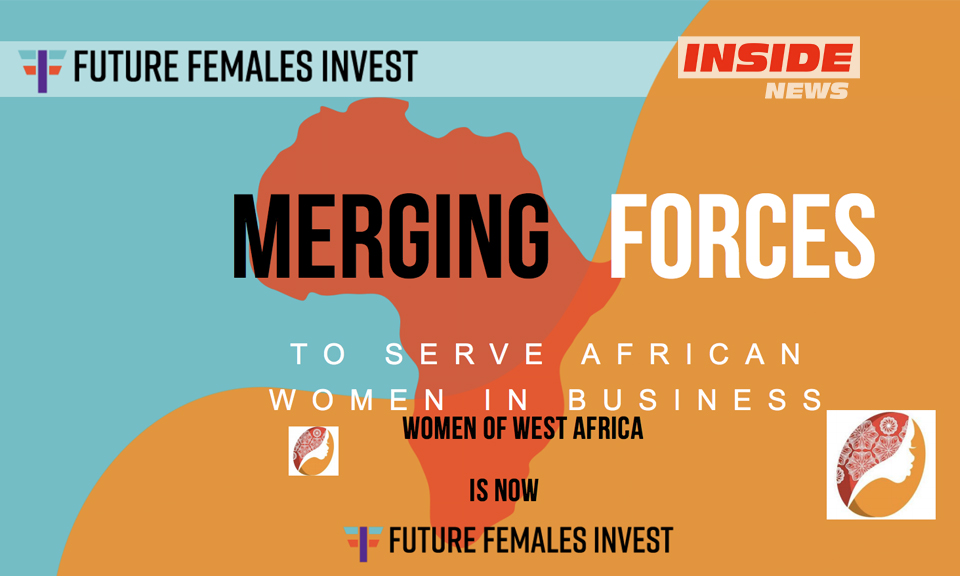
FFI a tenu une conférence de presse virtuelle le jeudi 16 octobre 2020, réunissant des intervenants de plusieurs régions du continent. Outre la Chief Executive Officer de l’organisation, Aysha Julie, cette rencontre a également vu la participation de Christine Umutoni, coordinatrice résidente de l’Organisation des Nations Unies et représentante de l’UNDP pour Maurice et les Seychelles, de Nousrath Bhugeeloo, conseillère auprès du FFI, du Dr Audrey Verhaeghe du South African Innovation Summit et du Dr Nadia El Shaffei, consultante en ressources humaines et partenaire de FFI pour le Moyen-Orient. Parmi les sujets abordés, le projet Ready to Thrive, subventionner par la Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) une plateforme créée pour soutenir les femmes entrepreneurs de l’île à affronter la pandémie de Covid-19 et ses répercussions. Ready to Thrive offrira aux participantes la possibilité d’avoir accès à des outils pertinents.
La plateforme FFI, fondée par Aysha Julie et Torera Abiola, croit fermement que les femmes sont l’avenir du monde des affaires. Lors de la conférence de presse, les intervenantes sont revenues sur les stratégies à adopter pour répondre aux besoins des femmes africaines et des moyens à être mobilisés pour leur permettre d’avoir accès aux opportunités financières. L’idée est de proposer des solutions visant à les autonomiser économiquement. Il s’agit de changer les écosystèmes d’investissement pour créer un environnement propice.
FFI offre aux femmes chefs d’entreprise en Afrique des formations, des conseils, un soutien pour développer leur modèle d’affaires et investir, ainsi qu’un accès aux marchés et aux opportunités d’investissement. Depuis 2013, l’organisation a permis de renforcer l’autonomie et l’influence de plus de 800 femmes en Afrique, notamment à travers la réalisation de projets en Afrique du Sud, au Nigeria, en Tanzanie et à Maurice. Les formations soutiennent également les organisations qui souhaitent investir dans des initiatives ayant un impact positif en aidant financièrement les femmes en Afrique.