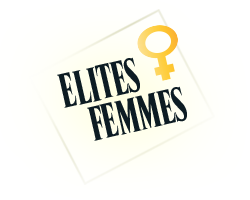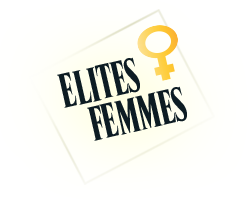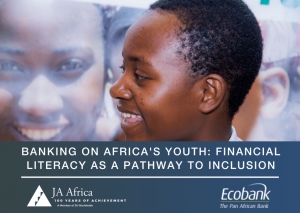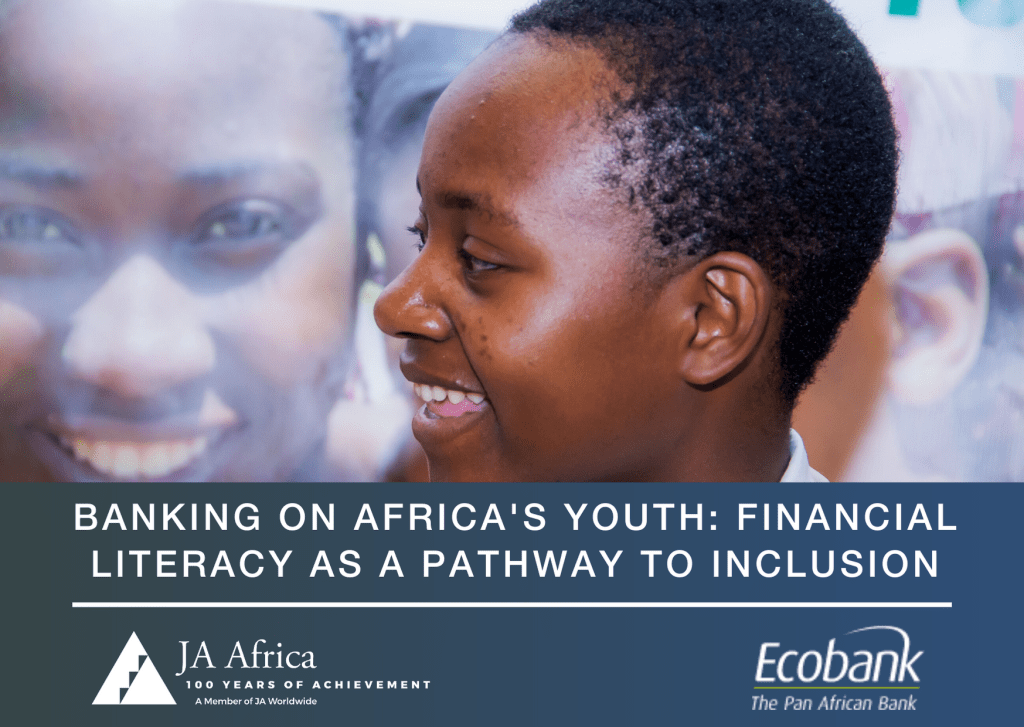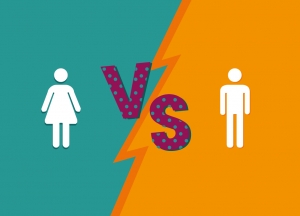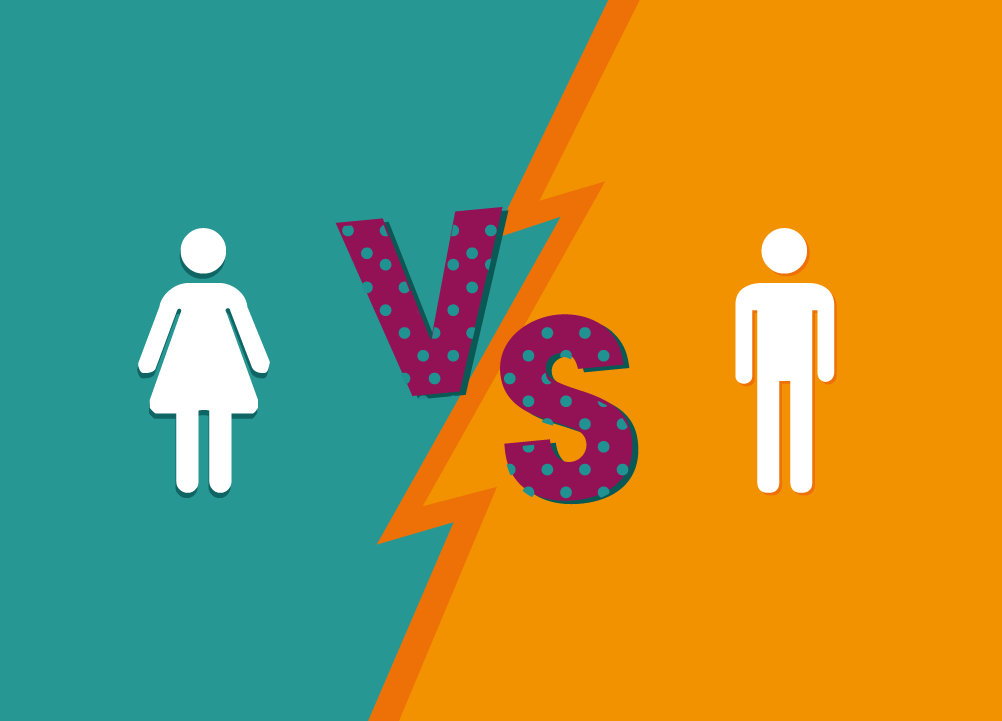L’Afrique est désormais leader mondial en matière d’entrepreneuriat des femmes. Pour Fannie Delavelle et Léa Rouanet, expertes auprès de la Banque mondiale, la pleine réalisation de leur potentiel économique contribuerait massivement à la croissance et à la prospérité du continent.

L’Afrique est en avance sur le reste du monde en ce qui concerne le nombre de femmes entrepreneures. Sur le continent, les femmes sont en effet davantage susceptibles de devenir entrepreneurs que les hommes : elles représentent en Afrique 58 % de ceux qui travaillent à leur compte. Toutefois, le récent rapport de la Banque mondiale, Les bénéfices de la parité, montre qu’en Afrique subsaharienne, les femmes entrepreneures continuent de réaliser des bénéfices inférieurs en moyenne de 34 % à ceux des hommes.
L’entrepreneuriat des femmes : nécessité fait loi Sur l’ensemble du continent, les femmes sont davantage enclines à choisir l’entrepreneuriat, non par passion ou du fait d’aptitudes particulières, mais avant tout par manque d’alternative. Les opportunités de travail salarié sont rares, à plus forte raison pour les femmes qui ont souvent un niveau d’éducation moins élevé et qui sont confrontées à des pratiques de recrutement discriminatoires. C’est aussi aux femmes que revient généralement l’essentiel des responsabilités domestiques, comme s’occuper des enfants. Gérer une petite entreprise à domicile est souvent l’un des rares moyens qu’elles ont de contribuer au budget familial. Il s’agit là véritablement d’une occasion manquée. Sachant que le continent africain est aujourd’hui leader mondial en matière d’entrepreneuriat des femmes, on mesure à quel point la pleine réalisation de leur potentiel économique pourrait contribuer massivement à la croissance et à la prospérité du continent. Si nous réussissons à mettre les entreprises détenues par des femmes sur un pied d’égalité avec celles des hommes et à favoriser leur croissance, les économies africaines se développeront. L’autonomisation et le renforcement des femmes entrepreneures reviennent tout simplement à la mise en pratique d’une économie intelligente.
La collaboration avec le secteur privé produit des synergies : elle doit constituer un élément central des efforts engagés pour accroître les opportunités offertes aux femmes entrepreneures en Afrique – et ce dans une triple perspective. Promouvoir les entrepreneures en domaine masculin Tout d’abord, il faut s’attaquer aux contraintes sous-jacentes, inhérentes aux normes sociales, qui constituent des entraves pour les femmes. Parmi ces freins : le partage inégal de la charge de soins aux enfants, mais aussi les conventions qui poussent les femmes vers des secteurs d’activité moins rentables. En Éthiopie ou en Ouganda, par exemple, les études ont montré qu’en matière d’entrepreneuriat, la « ségrégation sectorielle » était un déterminant majeur des écarts de revenus entre les sexes. Ainsi, en Ouganda, le bénéfice mensuel moyen dans le secteur de l’esthétique, où les femmes sont majoritaires, est de seulement 86 dollars contre 371 dollars dans le secteur de l’électricité, à forte domination masculine.
Le rapport de la Banque mondiale expose également qu’en République démocratique du Congo, un quart du différentiel de bénéfices entre les femmes et les hommes est attribuable au fait que les femmes travaillent dans des secteurs comparativement moins rentables. Ces résultats concordent avec une récente étude du Gender Innovation Lab, réalisée à partir des pages Facebook d’entreprises de 97 pays sur quatre continents. L’étude révèle plusieurs faits à l’échelle internationale : les entrepreneurs travaillant dans les domaines à dominante masculine ont les revenus les plus élevés. En moyenne, ils gagnent 116 % de plus que les entrepreneures dans des secteurs à dominante féminine ; les hommes dans les secteurs à dominante féminine se situent à un niveau intermédiaire ; enfin, les femmes dans les secteurs à dominante féminine ont les revenus les plus faibles. Ces études révèlent que les choix d’activité féminins ne sont pas toujours déterminés par les facteurs auxquels on pourrait s’attendre, comme l’éducation ou l’accès aux capitaux. Les déterminants principaux du choix sectoriel sont plutôt l’exposition des hommes aux secteurs dominés par d’autres hommes via des mentors masculins, la formation ou la pratique professionnelle, et l’accès à l’information comparative sur les différences de revenus entre secteurs. Le secteur privé peut, à cet égard, jouer un rôle clé en encourageant les femmes à passer de l’autre côté, notamment par le biais d’une démarche d’incubateurs ou par le développement de programmes internes aux entreprises.
Enseigner des compétences adaptées aux femmes entrepreneures
La plupart des pays d’Afrique sont parvenus à la parité filles-garçons dans l’accès à l’enseignement primaire, mais un fossé persiste dans les niveaux d’éducation et de compétences atteints par les entrepreneurs femmes et hommes, en particulier à partir de l’enseignement secondaire. Cela pourrait expliquer les différences en matière de décisions stratégiques dans les affaires. Les femmes à leur compte ont, dans l’ensemble, suivi des études moins longues que les hommes, qui sont souvent techniquement plus qualifiés. L’étude Les bénéfices de la parité montre que les programmes de formation qui dispensent à des femmes entrepreneures des compétences classiques, comme la comptabilité, produisent souvent des résultats décevants. Certains travaux prometteurs laissent penser que l’enseignement de compétences socio-émotionnelles, telles que l’initiative individuelle ou la persévérance, auraient davantage d’effets. Au Togo, une formation destinée aux dirigeantes de petites entreprises sur « la prise d’initiative, les comportements proactifs et la persévérance » a donné des résultats impressionnants : les apprenantes ont vu leur bénéfice augmenter en moyenne de 40 % suite à la formation. Celles qui assistaient à un cursus business classique n’ont, quant à elles, enregistré aucune augmentation significative de leur bénéfice. Une entrepreneure togolaise qui louait des robes de mariage a, par exemple, décidé d’élargir sa clientèle après avoir suivi un cours sur l’initiative individuelle. Elle vend aujourd’hui des robes et des accessoires, et possède des boutiques dans trois pays d’Afrique. Des formations de ce type ont été déployées dans différents contextes et dans d’autres régions du monde, comme l’Amérique latine ou les Caraïbes, avec des résultats très positifs. Elles pourraient être disponibles partout en Afrique via des partenariats avec le secteur privé : à la fois auprès des grandes entreprises et des petites structures de femmes entrepreneures.
Des actions simples et peu coûteuses pour l’entrepreneuriat des femmes De telles interventions doivent, en outre, être mises en œuvre à différentes échelles. La Banque mondiale a démontré que des actions simples et peu coûteuses peuvent avoir un fort impact sur l’autonomisation des femmes. Au Malawi, par exemple, nous nous sommes aperçus qu’encourager les femmes à enregistrer leur entreprise n’avait aucun impact sur leurs bénéfices. Mais en ajoutant à cet enregistrement une réunion d’information dans une banque, avec ouverture d’un compte bancaire d’entreprise, la palette des services financiers formels utilisés par les femmes s’accroît de façon significative, et leurs bénéfices augmentent de l’ordre de 20 %. Le coût de cette opération : 27 dollars par entreprise. Cet appui peu coûteux est essentiel en Afrique subsaharienne, où seulement 27 % des femmes ouvrent un compte dans une institution financière. Autre exemple de collaboration fructueuse avec le secteur privé : l’appui des outils psychotechniques. Face aux difficultés des femmes à accéder aux capitaux, deux réponses sont possibles : soit leur donner un meilleur contrôle des actifs, par exemple via des droits de propriété conjoints, comme au Rwanda, soit contourner totalement les contraintes de collatéral sur les prêts.
En Éthiopie, grâce à un partenariat avec le secteur privé, la Banque mondiale a ainsi introduit comme alternative au collatéral une batterie de tests psychométriques innovants. Très fiables, ces tests prédisent la probabilité de remboursement d’un crédit par les entrepreneurs, avec au bout du compte des taux de remboursement de 99 %. Une telle initiative a pu bénéficier par exemple à Abeba, propriétaire d’une boulangerie dans la région éthiopienne d’Amhara, qui ne pouvait prétendre, depuis près de dix ans, qu’à des prêts collectifs plafonnés à 900 euros. Grâce aux tests, elle a pu bénéficier d’un crédit en son nom, faire fructifier son affaire et diversifier ses revenus. L’entrepreneuriat des femmes au cœur des politiques de développement Le développement des entreprises est un moteur essentiel de la croissance économique et de la création d’emploi. Sans l’entrepreneuriat, il y aurait peu d’innovation, peu de croissance de la productivité et peu de nouveaux emplois.
Les dirigeants et de nombreuses autres parties prenantes en Afrique reconnaissent de plus en plus que les femmes entrepreneures sont déjà un levier de croissance, mais qu’elles pourraient l’être davantage. Pour combler les écarts entre les sexes, il faut identifier et mettre en œuvre des programmes et des politiques qui ciblent les contraintes spécifiques auxquelles les entrepreneures sont confrontées. Comme nous l’avons montré, il existe des interventions ciblées qui sont simples, abordables et surtout à fort impact. Plus de la moitié des entrepreneurs en Afrique sont des femmes : la promotion de l’égalité femmes-hommes est un choix économique judicieux et une bonne pratique de gestion pour les entreprises. Elle doit être au cœur des politiques de développement.
ideas4development.org